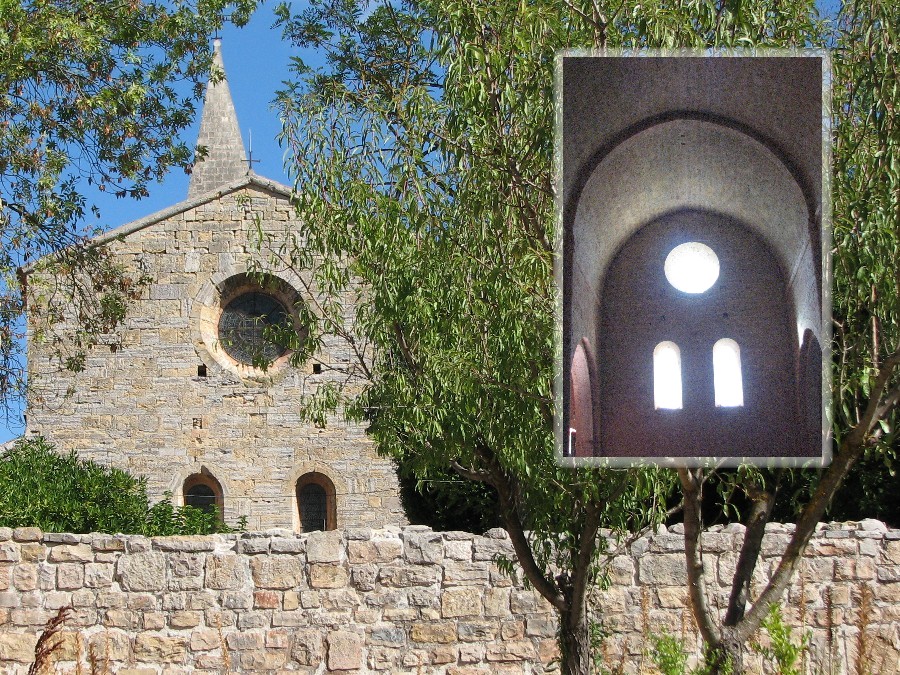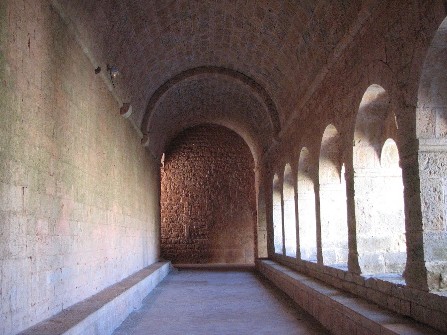|
L'abbaye
cistercienne du Thoronet
" Au
sud-est de Lorgues et sur un point intermédiaire entre Carcès et
Cabasse, au bord d'un vallon agreste, au milieu de collines boisées
dont les cimes interceptent les sites environnants, s'élèvent les
ruines de l'abbaye du Thoronet. Les chemins qui aboutissent au
monastère sont de toutes parts difficiles et très-accidentés. On dirait
que la civilisation moderne hésite avant de venir troubler la majesté
et la solitude de ces lieux. " (Histoire de la commune de Lorgues - Par
François CORDOUAN - 1864).
|

Avec ses
sœurs, Silvacane
et Sénanque,
l'abbaye du Thoronet
est l'une des trois abbayes cisterciennes de Provence. En 1136, un
groupe de moines quitte l'abbaye de Mazan pour fonder un monastère,
qu'ils bâtiront 15 ans plus tard près de Lorgues, en un lieu boisé
entre le coude d'une petite rivière et une source. L'édification débute
en 1160 et se prolonge jusqu'en 1230. Au début du XIIIe siècle, le
monastère abrite une vingtaine de moines et quelques dizaines de frères
converts.
|

| " Le
Thoronet. Thoronelum, Tonindum, Floresia. Cette abbaye fut fondée
par Raymond Bérenger, comte de Barcelone et marquis de Provence, en
l'honneur de Notre-Dame, à Floriege, et transférée, quarante années
plus tard, A quelques lieues de là, au Thoronet. Les premiers moines
vinrent de l'abbaye de Mazan. Fouquet ou Foulques, abbé de ce monastère
(1170), poète estimé avant sa profession monastique, fut élevé sur le
siège épiscopal de Toulouse (1174), où il combattit énergiquement les
Albigeois. Les reliques du B. Guillaume, religieux de celle abbaye au
XIIe siècle, y étaient l'objet d'une grande vénération. On conserve
l'église, le cloître, le chapitre et le cellier du monastère bâti à
celle époque les autres constructions ont été remaniées au XVe et au
XVIIe siècle. (Abbayes et prieurés de l'ancienne France - 1909). |

| Moins de
deux siècles plus tard, le déclin de l'abbaye
est déjà entamé. En 1660, le prieur signale la nécessité de la
restaurer. En 1699, on déplore fissures et effondrement des toitures,
portes rompues et fenêtres délabrées. En 1790, sept moines âgés y
résident encore. La disparition de l'abbaye menace lorsque Prosper
Mérimée la sauve en la signalant à Révoil, architecte des monuments
historiques. |
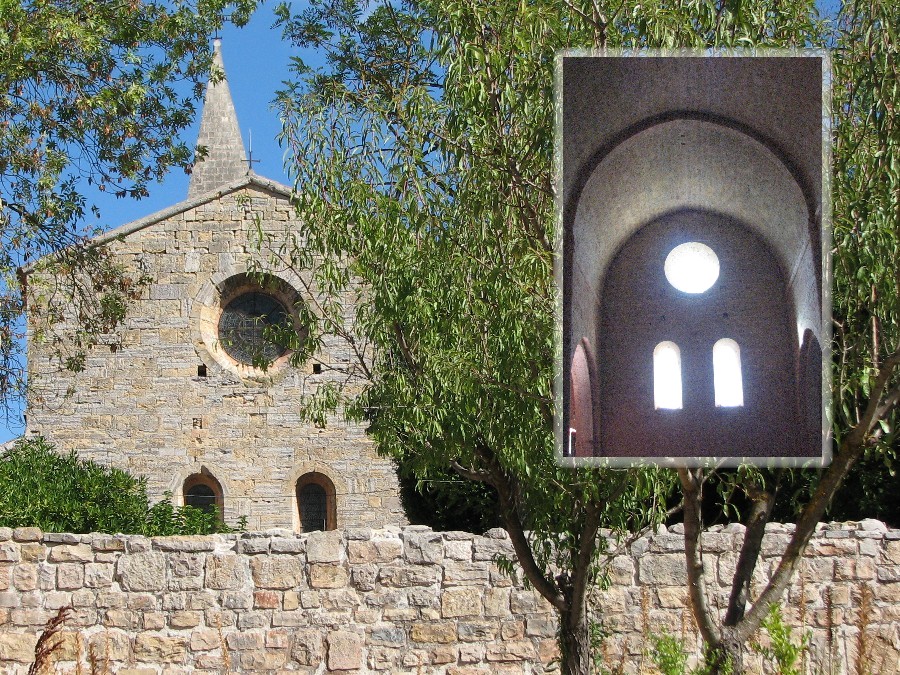
| " L'architecture
extérieure de l'Eglise est d'une simplicité remarquable, elle ne se
dessine que par ses assises horizontales, irrégulières de pierres dure
suivant la hauteur des bans de carrière, et par ses joints verticaux
correctement taillés. Pas de moulure, pas de saillie, que le simple
profil du cordon en quart de rond traditionnel qui est sous les pentes
et qui souligne les rives des toitures." (Mémoires de
l'Institut historique de Provence - 1939). |

L'acoustique
exceptionnelle de la nef est mise à profit pour l'enregistrement de
chants religieux, notamment grégoriens dont le rythme s'accorde avec la
résonance des lieux.
" L'intérieur de l'Eglise a la forme de la croix, plan particulier à
l'ordre de Cîteaux. Trois nefs parallèles en forment la base : le
transept, les bras et les absides, la tête. La largeur des trois nefs
réunies est de vingt mètres dans œuvre, leur longueur du mur de façade
à celui du chœur est de vingt quatre mètres. Les murs latéraux de la
nef sont percés chacun de trois arcatures dites à tiers-point, c'est à
dire à deux centres et par suite, à deux courbes qui se joignent au
sommet en angle curviligne. ...
Telle est l'ordonnance architecturale de cette église qui peut contenir
huit cent personnes et qui a été conçue en conformité avec la règle de
Saint-Bernard. Elle est en effet d'une simplicité toute monacale. Les
murs sont nus, sans moulure ni cordon que les architraves qui séparent
les lignes verticales des voûtes et des arcs, et celles-ci n'existent
que du côté des intrados de ces arcs ; pas d'archivoltes, pas même de
socle. l'aspect monumental et grave n'a été obtenu que par la pureté
des lignes, par une élévation bien ordonnée, par la disposition dégagée
du plan et par un éclairage savamment distribué qui donne de
l'importance à la nef centrale, au chœur et laisse dans une
demi-obscurité les bas côtés ; enfin, par les jeux de lumière, sur les
pierres auxquelles huit siècles ont donné une patine chaude et bleutée.
" (Mémoires de l'Institut historique de Provence -
1939). |

" Trois
parties
sont à distinguer dans l'Abbaye du Thoronet : l'Eglise, le Cloître, les
Bâtiments claustraux. On retrouve dans leur architecture l'explication
stricte de la règle de St Bernard qui disait : « l'Eglise brille dans «
ses murailles et elle est nue dans ses pauvres ! Elle couvre d'or ses
pierres et laisse ses fils sans vêtements. Les curieux ont de quoi se
distraire et les malheureux ne trouvent pas de quoi vivre ».
Pour remédier à cet état de choses, le fondateur de l'ordre de Cîteaux
prescrivit à ses disciples des dispositions très sévères : les abbayes
devaient être bâties dans les solitudes et nourrir leurs habitants par
des travaux agricoles. On ne devait pas chercher à les fonder sur de
saints tombeaux de peur d'y attirer les foules de pèlerins et avec eux
la dissipation du siècle. Les constructions devaient être solides et
autant que possible en bonnes pierres de taille, mais sans aucune
superfétation, pas même d'autre clocher qu'un petit campanile, parfois
en pierres et presque toujours en charpente. Enfin, Saint-Robert
compléta ces sévères prescriptions en précisant la disposition que
devaient avoir les bâtiments. " Ces règles furent appliquées d'une
façon rigoureuse au Thoronet. (Mémoires de l'Institut historique de
Provence - 1939). |
 
L’eau
dans
chacune des abbayes cisterciennes est un élément indispensable de la
vie quotidienne. Une importante quantité d’eau, potable ou non, était
nécessaire. L’abbaye n’en manquait pas et l’aridité actuelle du vallon
n’est pas significative de la situation antérieure. Cette
aridité résulte de l’extraction après la Seconde
Guerre mondiale de la bauxite provoquant la disparition des ruisseaux
et
l’assèchement des couches géologiques. Cela eut également pour effet de
provoquer des glissements de terrain qui ont emporté la partie
nord de l’aile des moines ainsi que le réfectoire. L’alimentation
en eau pour les besoins alimentaires, sanitaires et liturgiques se
faisait par la source située au sud-ouest de l’enclos. Un débit
constant arrivait jusqu’au monastère par un réseau de
canalisations fait d’une maçonnerie de moellons soigneusement
appareillés.
" ... les Cisterciens du XIIe siècle s'occupaient à de rudes travaux
manuels ; il leur fallait avant d'entrer à l'église ou au réfectoire,
laver leurs mains de toute souillure. Aussi voyons-nous que les lavabos
des monastères cisterciens sont une partie importante du cloître. Celui
qui nous occupe est une salle hexagonale tenant à la galerie du cloître
qui longe le réfectoire ; les religieux entraient dans la salle par une
porte et sortaient par l'autre de manière à éviter tout désordre ; ils
se rangeaient ainsi autour du bassin au nombre de six ou huit pour
faire leurs ablutions.
Conformément à la règle de Cîteaux, cette salle est extrêmement simple,
couverte par une coupole en pierre, à cinq pans, avec arêtiers dans les
angles rentrants. Au centre se trouve un bassin à huit pans reposant
sur un gradin. Un piédouche supporte une vasque située au sommet du
lavabo et distribuant l'eau. Elle comporte un système perfectionné de
distribution des eaux par seize petits becs. Cette vasque qui a un
mètre trente cinq de diamètre et dont le fond est à dos d'âne reçoit
l'eau par un tuyau vertical placé en son milieu et couronné en crépine.
Le sol de l'édicule est légèrement en pente dirigée au nord et comporte
deux gradins circulaires également en pente de ce côté. Cette
disposition permet l'évacuation des coulures dans un regard. "
(Mémoires de l'Institut historique de Provence - 1939).
|

" Le
dortoir, situé au-dessus de la salle
capitulaire communiquait avec l'église. On comprend que là devait être
en effet le dortoir quand on considère que cette aile se liait au
transept, ce qui rendait plus facile l'accès du chœur pour les offices
de nuit.
Il y a vingt huit mètres de longueur et huit mètres cinquante de
largeur. La voûte à tiers point est coupée dans sa longueur par des
arcs doubleaux. Le cerveau de la voûte est à huit mètres trente du sol.
Le mur est, est percé sous cordon architrave de la voûte, de onze baies
plein cintre en éventail à l'intérieur du mur et laisse à chacune une
ouverture de soixante treize centimètres de largeur. Le mur latéral
ouest
ne comporte que sept baies de la même ordonnance mais dont les jambages
à mi-mur, à arêtes vives ne laissent qu'un vide d'ouverture de trente
centimètres. Il existe dans le même mur deux portes avec quelques
marches en montée qui conduisent au sol des galeries du premier étage
du cloître. Au dessus de la porte donnant dans l'église se voit une
poutre moulurée, percée d'un trou destiné à porter une lampe. ... "
(Mémoires de l'Institut historique de
Provence - 1939). |



| Le
cloître forme le centre du monastère, il fait le lien entre l'église et
les bâtiments de la vie communautaire. Il mesure en moyenne 30 mètres
de
côté, comme la plupart des cloîtres cisterciens. Il est en forme de
trapèze allongé, suivant deux axes : celui du cellier (décalé
de quelques degrés d’un axe Nord-Sud), et celui de l’abbatiale,
parfaitement orienté. Les arcades sont dites géminées (doubles)
surmontées d'un oculus ajourant les tympans et les chapiteaux dépourvus
de tout ornement. |

" A
l'instar de la plupart des abbayes, le cloître est composé du préau,
entouré de quatre galeries. Son plan a comme dans tous les monastères
cisterciens, la forme d'un trapèze. Il est encadré au sud par l'église,
à l'Ouest par les caves, à l'est par la salle capitulaire, la
bibliothèque, l'escalier conduisant au dortoir, au nord par le
réfectoire. ...
|

La galerie qui
longe le mur de la nef est à niveau plus élevé que les
autres galeries. Conçu suivant le caractère particulier de
l'architecture
cistercienne, ce cloître ne possède aucune de ces galeries délicates
recouvertes le plus souvent de charpentes, rappelant encore l'impluvium
antique. Les voûtes ont remplacé les lambris, la sculpture et les vains
ornements ont fait place à la force et à la durée. " (Mémoires
de l'Institut historique de Provence - 1939). |


" Parmi les
bâtiments claustraux, aujourd'hui incomplets, il faut mentionner la
belle salle capitulaire dont la voûte repose sur de massives colonnes,
aux chapiteaux ornés seulement de feuilles d'eau, de crosses abbatiales
croisées comme des épées et d'une main tenant la crosse ; ce sont des
symboles de l'autorité souveraine exercée par l'abbé. " (L'abbaye de
Fontenay et l'architecture cistercienne - Lucien Bégule).
" Servant aux réunions du Chapitre, cette salle à laquelle on accède en
descendant cinq marches a neuf mètres cinquante de long et huit mètres
de large. Elle est divisée dans le sens de la longueur par deux
colonnes trapues reposant sur des bases moulurées, avec griffes aux
angles et couronnées par des chapiteaux à feuilles taillées largement
avec de forts et larges tailloirs qui reçoivent les nervures de la
voûte, déployées en forme de palmes dont les extrémités dirigées sur
les murs reposent sur des culs de lampes. Des bancs de pierre disposés
en gradin étaient adossés aux quatre murs de la salle.
L'ornementation des chapiteaux quoique sobrement exécutée est composée
de feuilles d'eau, de branches de palmier, de fleurs, de pommes de pin.
Sur l'un de ces chapiteaux on remarque une croix fichée et sur l'autre
une main tenant la crosse. Il est à noter que ce sont là les seules
sculptures que l'on puisse trouver dans toute l'abbaye. Elles semblent
indiquer que le pouvoir abbatial dominait là, en souverain. " (Mémoires
de l'Institut historique de Provence - 1939). |

 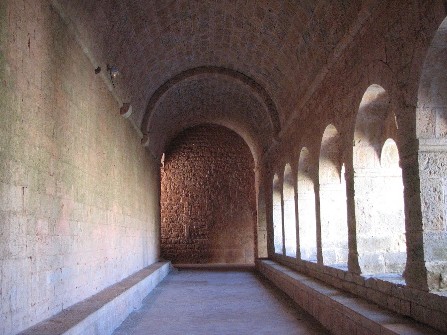
| Les
principes fondateurs de l'ordre cistercien. A l'aube du XIIe siècle,
l'ordre monastique clunisien atteint son apogée et affiche puissance,
gloire et richesse. Un moine Robert de Molesne, réagit et décide de
revenir à l'ordre strict de Saint Benoit rédigé en 534, qui prône
l'humilité, la pauvreté et le juste équilibre entre travail manuel et
prière. En 1098, il fonde le monastère de Cîteaux, près de Dijon, qui
donne son nom au nouvel ordre. A partir de 1109, Etienne Harding
codifie les règles cisterciennes. |


"
THORONET, abbaye commendataire d'hommes, situées à une lieue et demie
de Lorgues, au diocèse de Fréjus, dans la basse Provence, elle vaut 5 à
6000 livres à son Prélat, qui paie 400 florins à la cour de Rome pour
ses bulles. " (Dictionnaire universel de la France, Tome VI - Contenant
la Description Géographique des Provinces ... - 1771 Avec Approbation
et Privilège du Roi).
|
 


 
" Le Cellier. A
l'ouest du cloître existe encore un magnifique cellier couvert d'une
haute voûte en berceau brisé renforcé par quatre arcs doubleaux
communiquant au sud avec un bâtiment planté d'angle et qui devait être
primitivement occupé par les convers. Un plancher divisait peut-être la
construction dans le sens de la hauteur, ce qui donnait un cellier en
bas et un grenier au-dessus. Les traces de la grande porte et du
pressoir sont visibles, dans le mur ouest, et une cuve maçonnée haute
de deux mètres, carrée de trois mètres de côté est montée encore dans
l'angle nord-est de cette salle. On accède au niveau supérieur de la
cuve par un escalier extérieur de pierre. Une autre grande cuve à
plusieurs compartiments occupe tout le fond du cellier.
Cette cuve paraît avoir été destinée à recevoir le vin (ndlr : photo de gauche, au fond),
la petite était sans doute réservée à l'huile. Le cellier dut être
construit vers 1200 comme la galerie du cloître contre laquelle il
s'appuie. " (Mémoires de l'Institut
historique de Provence - 1939). |


" Les bâtiments
après le départ des Religieux. C'est dans ses dépendances que le
monastère a eu le plus à souffrir du temps et des hommes. Les
dévastations commises par les acquéreurs d'une partie du domaine en
1791, en modifiant certains locaux qu'ils ont aménagés pour leur
logement ou pour abriter les bestiaux employés à l'exploitation de
leurs terres, ont causé une véritable mutilation de cette partie des
bâtiments. Il ne restait plus que des ruines, la plupart informes.
Seuls subsistaient encore, très délabrés, le bâtiment des cuves à vin,
celui du moulin où se trouvent un pressoir et une meule, une amorce du
bâtiment des fours, les restes de l'hôtellerie un peu écartée à l'ouest
des bâtiments clostraux et le bâtiment des cachots (?) situés de part
et d'autre de la poterne d'entrée, placée à l'ouest du cloître. "
(Mémoires de l'Institut historique de
Provence - 1939). |

| " La restauration
débute en 1841 pour ne plus cesser. En 1846, " L'abbaye
se composait de trois parties principales : de l'église, du cloître et
des bâtiments dans lesquels se trouvaient divers logements. La dernière
a été vendue le 17 mars 1791 par la nation, qui s'est réservée les deux
premières. Elle sert maintenant à loger les acquéreurs et à abriter les
bestiaux employés à l'exploitation des terres adjacentes. Inutile
d'ajouter que les traces du caractère primitif sont effacées et que la
pioche des nouveaux occupants a mutilé et détruit tout ce qui
s'opposait à la destination qu'ils lui ont donnée. " (Statistique du
département du Var - Par C. N. Noyon - 1846). L'Etat
achète progressivement le site à partir de 1854. |

Entre
1985 et 1990, des travaux considérables ont été réalisés : la
réfection de la couverture a permis d’une part d’alléger les voûtes (en
substituant au remblai lié au mortier une forme légère et étanche en
béton de chaux), le renforcement des reins de voûtes par des injections
de coulis de chaux, et enfin la reprise des fondations. Des travaux ont
lieu régulièrement en fonction des urgences (qui sont encore importants
notamment pour la grange dimière) et une surveillance continuelle du
niveau de l'eau est fort heureusement assurée pour prévenir de nouveaux
risques de glissements de terrains.
|
|